Débats / Enjeux
Les enjeux autour du patois
Une thématique souvent présente dans les discussions est celle de la forme à donner à la représentation écrite des patois : une forme plus unifiée aura l’avantage de faciliter l’intercompréhension entre des parlers différents, mais elle aura l’inconvénient de représenter moins bien le parler local. La position unificatrice a eu une influence considérable en France, parmi les défenseurs de l’occitan ; elle a étendu de là son influence, par similarité, vers le francoprovençal, dont certains, en France en particulier, ont espéré et espèrent atteindre les mêmes positions que celles qu’a gagnées l’occitan par des décennies de combat : une langue unifiée et pourvue d’autorité face à des variantes dialectales ; une orthographe unitaire appliquée strictement par les écrivains, les éditeurs et les enseignants ; la possibilité d’un enseignement calqué sur le modèle du français (une grammaire, une orthographe, la possibilité d’une évaluation de son respect) ; des postes d’enseignants obtenus à la suite d’un concours. Le nom donné à la variété de francoprovençal qui aurait été ainsi élaborée est arpitan (sur le modèle d’occitan, et avec le nom des Alpes, pourvu d’une évolution (rhotacisme) bien francoprovençale. L’argument appuyant ce grand effort d’élaboration, de codification (et de diffusion) est que lui seul permet de regrouper assez de forces pour défendre une langue avec succès, une variété trop faible par son nombre de locuteurs et d’écrivants étant vouée à la disparition.
Le plus souvent (mais pas toujours), les patoisants et militants suisses n’ont éprouvé que très peu d’intérêt pour ces objectifs et cette réalisation. Ils voient souvent l’intérêt de défendre la langue de leurs parents, de leurs grands-parents, de leur village ou de leurs voisins, mais beaucoup moins celui de défendre une langue qui n’est celle d’aucun de ceux-ci, et que ceux-ci ne comprendraient pas. L’attachement à la langue est souvent un localisme, et les patoisants n’éprouvent pas d’intérêt à remplacer ce rattachement à un lieu par une inscription dans un espace tri-national. Ce modèle a pourtant su trouver des sympathies, au moins partielles, en Suisse aussi, en particulier chez des militants dont le rapport au patois passe surtout par l’écrit et sa diffusion. La question de la normalisation linguistique (et d’une unification, quelle que soit l’échelle de celle-ci) se présente en effet très rapidement lorsque l’on élabore un système d’écriture : il existe par exemple une graphie unifiée servant à noter les parlers valaisans, et les systèmes purement phonétiques sont souvent jugés peu commodes par les patoisants, à la lecture comme pour l’écriture. L’absence d’unité oblige, si l’on veut élaborer un matériel pédagogique, à répéter l’opération pour chaque commune ou presque, ce à quoi on a échoué jusqu’à présent.
En somme, les positions sont différentes selon les différents porteurs de la tradition linguistique : ceux qui ont appris le patois dès l’enfance ou qui le pratiquent souvent à l’oral n’ont pas les mêmes intérêts que les néo-locuteurs qui l’ont appris sur le tard à l’aide de grammaires et de dictionnaires. Les premiers sont souvent très réticents à céder sur leur variété exacte, dont la différence avec celle des villages les plus proches leur est souvent très sensible ; les seconds voudraient pouvoir écrire avec aisance, contrôler facilement la correction de leur langue, et saisir toutes les occasions d’employer la langue qu’ils ont apprise ; les premiers éprouvent souvent moins d’intérêt à son usage véhiculaire.
![Les mots patois dans le ciel de Porrentruy, [Djasans] ©Léa Buchwalder](https://patois-romands.preview-tokiwi.ch/wp-content/uploads/2025/09/mots-patois-ciel.jpg)
Unification ou diversité linguistique
Et si l’on peut supposer que les auteurs de grammaires tendront parfois à souhaiter unifier les états linguistiques qu’ils décrivent, les auteurs de dictionnaires (qui sont nombreux parmi les patoisants, et qui exercent une fonction importante dans la discussion autour de la langue et dans sa conservation) auront plutôt la propension inverse : celle d’accorder une attention particulière aux unités propres à la variété décrite ou non communes à un vaste ensemble de parlers.
Mais les débats ne portent pas que sur ce point : la question du soutien de l’état (ou de la Confédération) n’est pas vue par tous comme un objectif aussi important : pour certains (en particulier certains responsables d’associations), les états cantonaux devraient assumer l’initiative des mesures visant à soutenir le patois, tandis que les administrations cantonales se voient plutôt comme un soutien des initiatives et des actions des acteurs associatifs.

La charte en débat
Un débat est né assez récemment de l’adhésion de la Suisse à la charte européenne des langues minoritaires, puis de l’inscription du francoprovençal et du jurassien sur la liste des langues minoritaires. Cette décision de la Confédération a été prise dans un but de soutien aux patois, et elle a été bien reçue par les patoisants et leurs regroupements. Les experts européens qui observent périodiquement si la Suisse remplit bien les obligations qu’elle a contractées en ratifiant la charte ont cependant une vision de la situation des patois qui peut différer des habitudes politiques suisses. Cela se comprend d’ailleurs fort bien : une seule charte, et une seule liste d’obligations, reposant sur des critères unifiés, doit s’appliquer à toute l’Europe, et aussi bien à la situation des populations russophones d’Ukraine ou roumanophones de Hongrie qu’aux locuteurs germanophones de Genève ou francoprovençalisants d’Evolène (ou de Sion). Dans le détail, cela a mené à certains désaccords entre les experts européens et les représentants des collectivités publiques suisses. Les enjeux sont dans un sens très importants (l’acceptation des demandes des experts européens pourrait aboutir à des modifications sensibles de l’ordre constitutionnel suisse sur les questions linguistiques), et dans un autre non (il est probable que les cantons et la Confédération ne modifieront pas sensiblement leur législation et leur cadre constitutionnel ; les patoisants ne peuvent être touchés qu’indirectement par les questions débattues).
Les enjeux de la position du patois dans la société du 21e siècle sont certainement liés aux questions plus vastes que pose l’inscription des identités personnelles dans un espace local, régional ou national. On aurait pu croire qu’ils auraient perdu toute importance de ce point de vue, plus de 100 ans après l’accélération très rapide de leur déclin, mais ce n’est pas le cas, et ils continuent à être employés par les habitants des villes comme des campagnes pour présenter et se représenter leur être au monde. Ils permettent d’ailleurs à cet emploi de prendre des formes variées, dont l’orientation politique est loin d’être univoque.
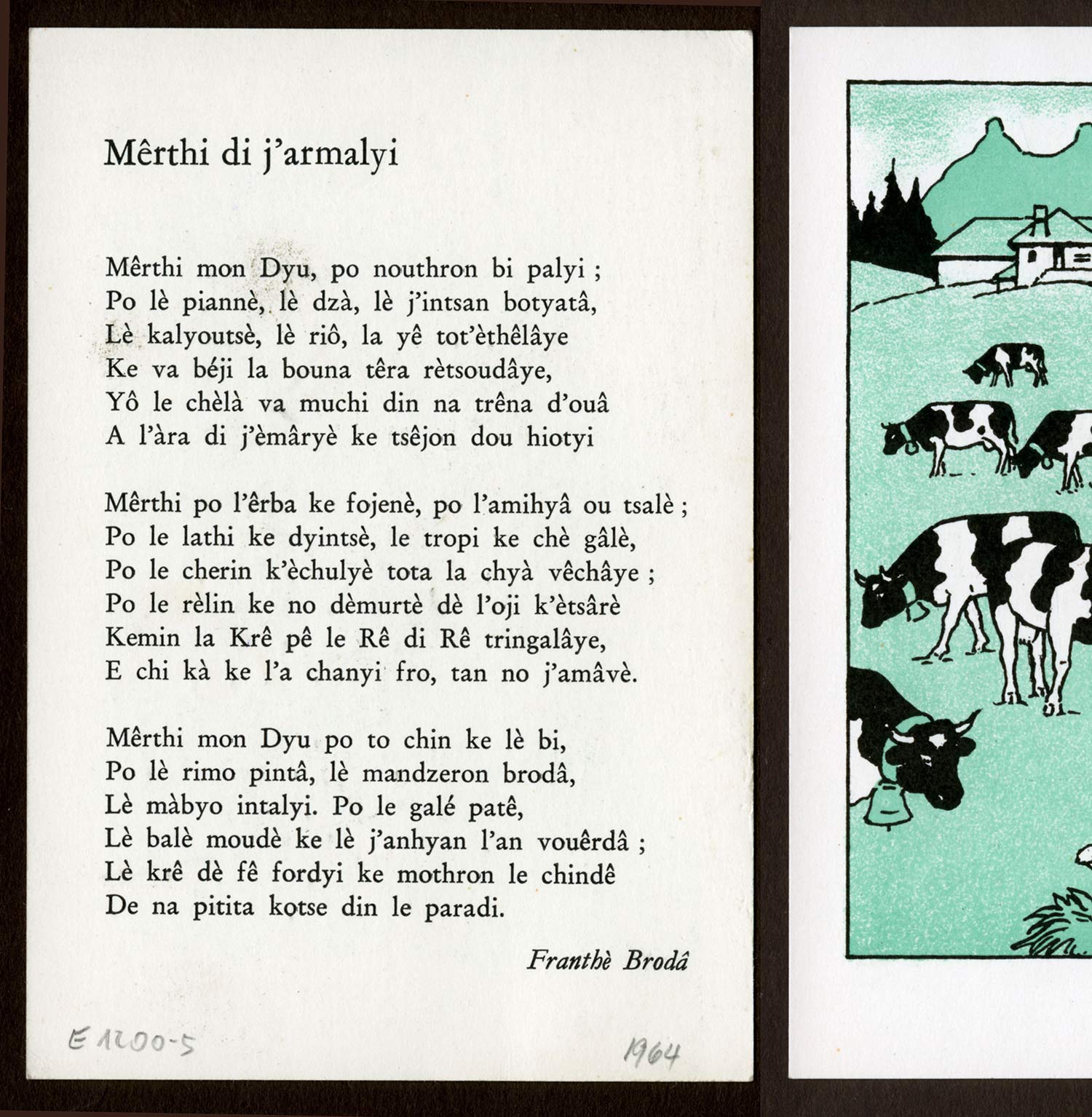
NB : Ces réflexions s’appuient sur des travaux menés dans le cadre du projet « Évolution des patois en Suisse romande : prédictions de vitalité, système linguistique et pratiques langagières » (GPSR-Unine et Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme, Fribourg) par Raphaël Maître, Marinette Matthey et Yan Greub. Voir en particulier M. Matthey, R. Maître, Y. Greub, Les patois romands aujourd’hui : entre décroissance, résilience et attentes, Fribourg, Institut de plurilinguisme, 2025.